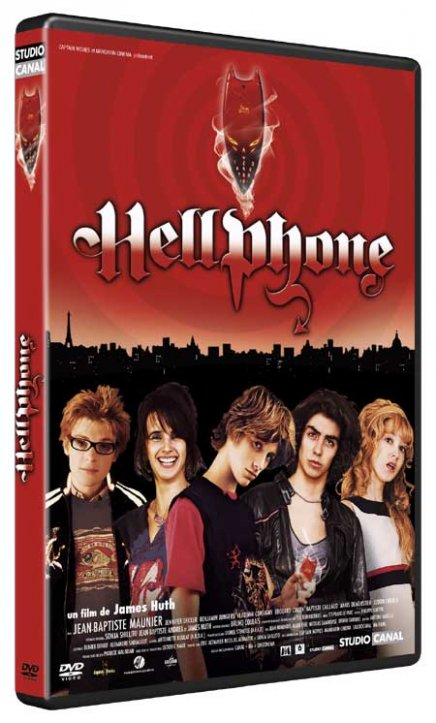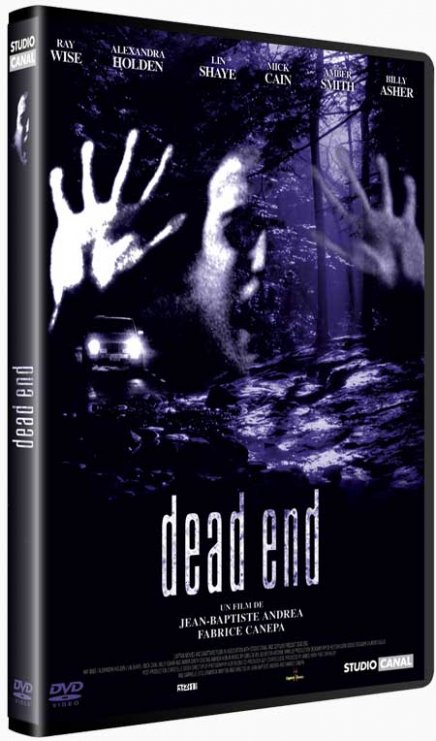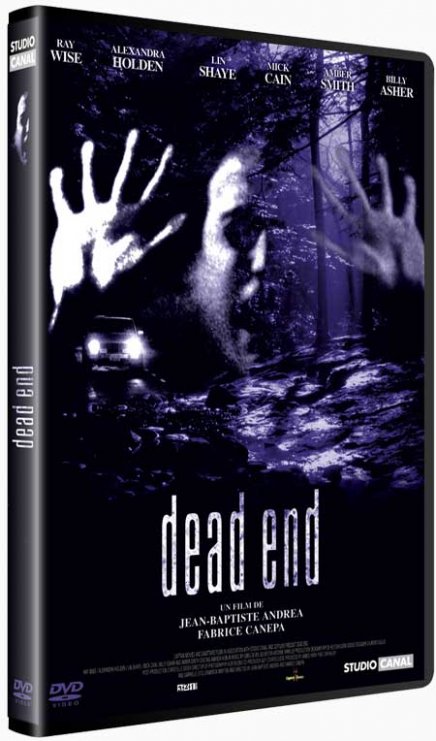Interview James Huth
Le 29/10/2007 à 10:20Par Arnaud Mangin

Passer quelques instants avec James Huth, c'est comme boire un verre avec un bon copain : avenant, franc, doué d'un sens de l'humour communicatif, passionné et passionnant lorsqu'il s'agit de son travail ou celui des autres, le réalisateur de Hellphone, Brice de Nice et Serial Lover montre rapidement que ses films ne sont pas une farce et qu'ils lui ressemblent grandement. Il ne fallait pas moins que la sortie en DVD de son petit dernier pour essayer de comprendre, avec lui, la place de son style atypique dans un paysage culturel conventionnel...
FilmsActu : Lorsque l'on découvre le destin de Hellphone et Dead End en salles, on est en droit de se demander ce qui cloche dans le cinéma français...
James Huth : Je vais citer un exemple, mais je ne veux pas que ça soit pris pour une comparaison. Vous savez pourquoi Charles Laughton n'a pas fait de second film après La Nuit du chasseur qui est pourtant un chef d'œuvre absolu ? Parce qu'il a eu des critiques désastreuses, qu'il a été mal reçu par la presse, et fatalement mal distribué puisque personne ne s'y intéressait. Résultat des comptes, le film a fait un four et on n'a jamais laissé la moindre chance à Laughton d'entamer son projet suivant. L'un des risques du métier repose sur la communication autour d'un film et du temps alloué pour communiquer. Hellphone est un film atypique, et la seule vraie façon de communiquer autour d'un film atypique c'est le bouche-à-oreille. Je pense et je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, mais le délai d'exploitation était bien trop court pour que le film se fasse sa petite réputation tranquille. Le cinéma est une industrie très rapide, qui s'emballe régulièrement et entre l'instant où vous terminez de fabriquer votre film et le moment où il sort, beaucoup de gens vous bousculent pour rapidement rentrer dans leur frais. Les banques entre autres, qui ne s'intéressent pas tellement à la manière de vendre une œuvre. Je me retrouve donc en France, avec mon film français qui ne ressemble pourtant pas à ce que font les comédies françaises traditionnelles, et je dois très vite en faire parler sans que les gens sachent à quoi s'attendre, ni même leur faire comprendre que c'est un gros mélange de genres. J'aurais aimé passer par des festivals, ou des choses comme ça. Mais je n'en n'ai pas eu le temps. C'est un film qui fait peur, commercialement parlant...
Aller au cinéma est un risque ?
Pour tout le monde, et surtout pour le spectateur. Aujourd'hui, aller au cinéma ne se résume pas à votre place qui coûte 10 euros. En général, on y va à deux, on invite l'autre personne, on va se faire un restaurant avant, boire un coup après et si vous avez des enfants vous devez payer une baby-sitter. Les gens n'ont pas envie de faire un mauvais investissement et se fient à des affiches et des bandes annonces rassurantes. Si je débarque avec un film tellement barré et que je n'arrive pas à convaincre en deux minutes avec une bande annonce claire, je perds mon spectateur. De toute façon, le meilleur agent pour un film atypique, c'est l'œuvre elle-même. On ne résume pas un film sortant des normes à travers une simple bande annonce ou une affiche...
Quels échos avez-vous reçu de la part des spectateurs ?
Plutôt bons, et ça correspond à cette idée de bouche-à-oreille. J'ai rencontré quatre personnes, des jeunes, qui m'ont dit expliqués qu'ils étaient parvenus à déplacer toute leur classe pour aller voir le film. Quatre personnes arrivant à en convaincre trente ! Ca correspond à la communication telle que je l'idéalise mais avec les multiplexes, ce genre de manœuvre doit fonctionner immédiatement. Si dès le premier jour les statistiques sont catastrophiques, le film dégagera la semaine suivante puisqu'il faut déjà laisser la place aux nouveaux films. Il faut démarrer fort dès le début, et donc véhiculer un bouche-à-oreille avant même la sortie... d'où l'intérêt des avant-premières.
A qui s'adresse le film exactement ? Le contexte et le fond s'orientent clairement vers les adolescents, mais dans la forme, on est plus proche d'un cinéma américain des années 80 qui ne parlera pas forcément à la jeune génération...
Comment le vendre ? Comme un film de James Huth (rires) !
Et les gens savent qui est James Huth ?
Je ne crois pas, non (rires). Pour moi, la cible d'Hellphone c'est du 9-35 ans. C'est venant de gens de cette fourchette là que j'ai eu le plus de retours positifs. D'ailleurs je ne me limite pas qu'à cette tranche puisqu'à la sortie du film, j'ai rencontré un monsieur de 76 ans qui avait adoré et qui y avait décelé des références ça et là dont moi-même j'avais oublié l'inspiration. Alors oui, dans l'absolu ça s'adresse à un public jeune mais en rencontrant les spectateurs et en discutant avec eux j'ai eu un pourcentage de satisfaction très élevé sur toutes les tranches d'age. Bien plus que pour Brice. Sur Brice de Nice, j'ai eu un tiers de gens qui ont adoré, un tiers qui s'est bien amusé et un tiers qui a détesté. Donc la satisfaction n'était pas totale, bien moins que Hellphone, mais on avait su donner envie aux gens de se déplacer à l'époque. Ce coup-ci, la majorité a aimé, mais on n'a pas su donner envie...Et quand je dis "C'est un film de James Huth", ce n'est pas une blague. Mon cinéma ne se fond pas dans un genre cloisonné à un seul public, mais c'est un mélange de plein de choses qui me plaisent et qui en font un univers cohérent. En tout cas, c'est vrai que je ne sais pas comment communiquer sur le film lorsque je suis en post-production. Je ne sais pas comment le résumer. La chose qui est sure, c'est que lorsque l'on me propose des projets qui ne collent pas, je sais tout de suite que ce n'est pas ça. J'en ai vu défiler des projets d'affiches, de bandes annonces, etc, pour chacun de mes films. Et très souvent, c'était de mauvaises idées. Faut croire que je n'ai pas encore réussi à trouver le bon axe sur cette partie de la fabrication.
C'était déjà le cas pour Serial Lover ?
C'était exactement la même chose. Sur le DVD français de Serial, je propose une petite bande annonce qu'on avait monté nous-même à l'époque. Un machin totalement décalé, qui nous avait fait mourir de rire mais qui ne correspondait pas du tout à ce que l'on est censé utiliser aujourd'hui. Idem pour l'affiche, où j'avais une idée de commercialisation mélangeant tout ce que j'aime. J'avais pensé tout ça comme un espèce de Pulp animé croisant la route de La Party qui brillait par cet élan d'énergie. Lorsque j'ai vu arriver l'affiche définitive de Serial Lover - je me souviens exactement où se trouvaient mes pieds dans l'agence de com à ce moment là - et lorsque ces mecs m'ont dit "Laisses-nous faire, t'es fatigué, on a quinze ans de métier derrière nous", j'ai compris que c'était perdu. Ce qu'ils m'ont présenté, j'avais pas envie d'aller le voir parce que ce n'était pas mon film. Toujours est-il que je n'ai pas encore la recette miracle, parce que rien ne dit que le film aurait mieux marché si on avait mis mon affiche. Ensuite, c'est la magie du cinéma... certaines choses aériennes cartonnent là où d'autres films super structurés se plantent. On ne peut pas tout expliquer. La chose que je retiens de tout ça, c'est que la conception d'un film ne s'arrête pas au dernier cut, mais qu'ils savoir aussi s'investir pleinement dans sa distribution et le guider jusqu'au bout.
Au final, ce ne serait pas plus facile de faire un produit conventionnel ? Les Bronzés 4 ?
(Rires). Je pourrais... Mais je ne suis pas sur qu'ils me laisseraient faire. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'un film c'est long à concevoir et ça demande énormément d'énergie. C'est tellement dur... on se dépense, on s'y implique parce qu'on y croit. Franchement, je ne pourrais pas me conformer à un produit auquel je ne crois pas. J'ai besoin de me sentir impliqué à 100% dans un film. Tout simplement parce que ça ne vaudrait pas le coup, sinon. Malheureusement pour mes parents, je ne suis pas conventionnel dans ma façon d'aborder la vie. En France, j'ai la chance de faire un film comme ça où l'on mélange les genres. Aux Etats-Unis, on m'aurait bloqué et on m'aurait demandé de faire soit un film d'horreur, soit une teen comedy. J'ai vraiment ressenti le besoin de mêler les émotions, de se dire qu'on peut s'inquiéter pour des personnages à un moment, et rire la seconde d'après.
Paradoxalement, Dead End que vous avez produit, mêle l'humour et l'horreur et a été tourné aux Etats-Unis parce que vous n'avez pas pu le faire en France. Vous y êtes vous retrouvé sur un plan artistique ?
Tout à fait, mais je ne veux pas leur retirer. C'est avant tout le film de Jean-Baptiste Andrea et Fabrice Canepa. C'est leur univers. J'ai accepté de le produire parce que je me suis effectivement un peu reconnu dans cette histoire qui n'hésite pas à mélanger les genres et qui le fait bien. C'était un projet dans lequel j'ai cru immédiatement. L'autre chose qui m'a décidé à produire, c'est de casser cette réputation voulant que réalisateurs et producteurs soient systématiquement en conflit. Je me suis toujours assuré que pour le bien et l'intégrité artistique d'un film, les deux devaient avancer dans la même direction. Ce n'est pas une chose difficile et ces deux mecs avaient vraiment envie de mener leur aventure jusqu'au bout. Pour un cinéaste, surtout un débutant, c'est important d'avoir un producteur derrière soi qui le comprend et le soutient. Un réalisateur demande à être accompagné, d'avoir les gens qu'il faut autour de lui. J'irai même plus loin dans mon raisonnement : que vous le vouliez ou non, vous faites partie du film en venant m'interviewer. Parce que si le film doit survivre dans le futur, il a besoin du DVD qui a lui-même besoin d'être exposé. Si on passe à côté de tout ça, à quoi bon sortir un DVD, à quoi bon le préparer, à quoi bon tourner le film et l'écrire ? Finalement, c'est un grand tout...
Hellphone et Dead End, disponibles en DVD sous la bannière de StudioCanal.
 FilmsActu.com
FilmsActu.com